Quand on parle d’horreur cosmique en littérature, le premier nom qui entre dans la conversation est celui d’H.P. Lovecraft, suivi de près par Clark Ashton Smith, August Derleth ou Robert E. Howard. Autrement dit, que des auteurs décédés qui ont squatté les revues pulp entre les années 1920 et 1950. J’aime profondément l’œuvre de Lovecraft ainsi que l’imaginaire du mythe qu’il a grandement participé à créer, celui des Grands Anciens, mais il est regrettable de voir l’absence d’un renouvellement créatif dans cette branche littéraire. Les caractéristiques étranges de ce sous-genre et la très grande productivité des maîtres de leur époque ont-elles eu raison des tentatives récentes d’exploration de l’indicible ?
De prime abord, on pourrait croire que les récits se sont grandement raréfiés avec le temps tant on peine à assimiler un quelconque auteur contemporain à cette mouvance. Cependant, que trouve-t-on si on se met à bien fouiller dans les bibliothèques et, surtout, existe-t-il des récits d’horreur cosmiques modernes qui méritent d’être lus ? Cet article n’a pas pour but de dénigrer les œuvres classiques ni de surélever celles plus modernes, mais plutôt d’évaluer l’héritage culturel d’un folklore fantastique une centaine d’années après son apparition.
La version cinématographique de cette question a été posée et répondue ici et ici, et si vous voulez lire d’autres articles axés sur la littérature ou l’horreur, vous pouvez trouver sur ce blog un article sur les livres fictifs, sur le found footage (Marble Hornets et la série V/H/S), ainsi que sur les histoires courtes (ici, ici et ici).
À lire également :
- Ces livres ont questionné mon humanité
- Que lire en Fantasy pour varier du médiéval européen ?
- Les Livres de SF que vous devez lire (partie 1 et partie 2)
- Amoureux de Dark Souls, lisez Elantris !
- Mon Année de lecture 2023
- Pourquoi le mouvement Hopepunk doit perdurer

Le Lovecraftian Horror, ça consiste en quoi au juste ?
Tirant son nom de son créateur officieux, le Cosmic/Lovecraftian Horror est un sous-genre du fantastique possédant, sous sa forme la plus répandue, plusieurs caractéristiques qui lui sont propres. De loin, on pourrait penser qu’il ne s’agit que d’une simple accumulation de monstres d’outre-espace et de dieux anciens, bien souvent réduits au seul Cthulhu pour le tout-venant et aux rares Azathoth, Dagon, Shub-Niggurath et Nyarlathotep pour les initiés, mais ce serait ignorer la profondeur de la bibliographie de certains de ces auteurs. Si ces êtres sont essentiels au Mythos, en ce qu’ils capturent parfaitement la notion cosmique du genre, les thématiques sont en réalité bien plus complexes.
Étrangement, le mot “cosmique” ne se réfère pas exclusivement au cosmos. L’une des choses les plus célèbres associées à Lovecraft est la peur de l’inconnu, et c’est ici que les étoiles interviennent. En effet, quoi de plus inconnu et terrifiant que le ciel profond en 1917 ? Plus précisément, il s’agit de l’effroi ressenti face à quelque chose que l’on ne peut ni comprendre, ni appréhender, ni envisager, ni anticiper. Cela peut se manifester de bien des façons, notamment dans des peurs plus intimistes et psychologiques, mais il faut admettre que la présence d’entités indescriptibles par le langage humain rend la terreur beaucoup plus concrète. Et pour cause, ces entités sont des divinités qui traversent des dimensions et évoluent dans des sphères de réalités si élevées qu’essayer de les comprendre nous plonge dans une profonde catatonie. Ce n’est pas quelque chose qui peut être atteint avec un bestiaire usé et abusé comme le diable, les vampires ou les zombies. Ils n’ont rien d’incompréhensibles, eux, et même s’ils nous tuent, on saura pourquoi et comment. Pas un dieu ancien. Pas un Yog-Sothoth.
L’une des autres spécificités, et quiconque s’est intéressé au genre a dû le remarquer, c’est l’exploitation extensive du format court. En effet, il existe très peu de romans d’horreur cosmique, mais beaucoup de nouvelles et de novellas. J’imagine que moins on en sait, plus on a peur, et que créer une familiarité avec des personnages ou avec un monstre peut réduire l’effet “inconnu” de la menace, nullifiant l’intérêt du genre. Cela se combine régulièrement avec la présence d’un narrateur indirect, de sorte que l’on n’est jamais vraiment sûr à 100% de la nature de ce dont on nous parle. La personne qui nous raconte l’histoire n’est presque jamais celle qui l’a vécue. Que ce soit par la lecture d’une lettre, le récit oral de quelqu’un ou bien un rapport scientifique, c’est presque toujours à travers une réaction indirecte que l’on perçoit la peur.

Plat du pied sécurité pour les héritiers
À la mort de Lovecraft, ses compagnons de correspondances (difficile de les appeler ses amis pour un tel misanthrope) et ses protégés ont continué à étendre le mythe à travers d’autres histoires, reprenant les noms et les tropes sans pour autant porter à proprement parler le flambeau. Le concept de l’Arlésienne, c’est-à-dire une chose dont on ne fait que parler sans jamais la montrer, s’est effacé au profit de confrontations plus directes, notamment à cause de la longueur des récits. Évoquer sans montrer sur une nouvelle de dix pages peut s’avérer diablement efficace, mais rapidement devenir redondant, voire même frustrant, sur un livre qui en fera trois cents. Pour schématiser, le format de la nouvelle a été abandonné pour celui du roman, et, dans cette continuité, les œuvres sont devenues plus proches de l’aventure fantastique que de l’horreur.
J’y reviendrais sans doute dans un autre article, mais grosso modo, August Derleth s’est évertué à créer un bestiaire de dieux plus organisé et hiérarchisé, ôtant par là même le caractère inconnu de la menace; Clark Ashton Smith s’est dirigé vers une voie plus proche du fantastique que du macabre; Robert E. Howard et Fritz Leiber ont dynamisé leurs récits avec des scènes de combats; ou encore Robert Bloch qui s’est quant à lui écarté de l’horreur surnaturelle, ce qui lui a plutôt bien réussi puisqu’il est l’auteur en 1959 du célèbre roman Psychose, adapté par la suite par Hitchcock. Ce dernier est tout de même retourné voir Lovecraft en 1979 dans son roman Retour à Arkham (Strange Eons en VO), mais ce livre semble être autant un hommage qu’une lecture parallèle des récits du maître de Providence.

C’est en 1981 que l’intérêt pour l’horreur cosmique reprend du galon grâce à la sortie du jeu de rôle Call of Cthulhu. Créé par Sandy Petersen, le jeu vous permet d’évoluer dans les ambiances malsaines d’Arkham, de l’université de Miskatonic ou d’Innsmouth, afin d’élucider les mystères laissés par les Grands Anciens. Nous sommes encore loin des années 2000, mais l’imaginaire collectif s’apprête à se réimprégner de la peur de ce qui se cache entre les étoiles. Même s’ils n’en sont pas des héritiers directs, on ne peut nier que Clive Barker et son roman court Hellraiser (1986), ou encore Stephen King à travers des œuvres comme Ça (1986 également) ou la nouvelle Brume (1985) ont contribué au regain d’intérêt du public et des écrivains d’aujourd’hui. L’un des héritiers les plus prolifiques est l’auteur américain Thomas Ligotti, qui conserve le format court des récits et publie à ce titre plusieurs recueils. Contrairement à beaucoup d’œuvres qui seront citées par la suite, lui a eu droit à quelques traductions françaises rassemblées dans le recueil Chants du cauchemar et de la nuit, publié en 2014 aux éditions Dystopia. Je ne le considère cependant pas comme un auteur moderne, puisque bon nombre des nouvelles de cet ouvrage avaient été publiées avant l’an 2000.
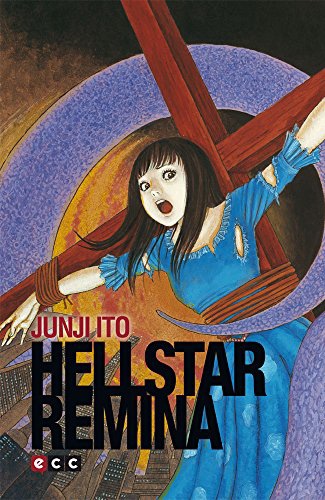
Le paradoxe des tentatives graphiques
Vous l’aurez compris, les mécanismes de la peur dans l’horreur cosmique passent par des choses qui ne peuvent, de par leur nature alien, pas être comprises par la psyché humaine. C’est un sentiment qu’il est donc incroyablement difficile à reproduire dans des œuvres graphiques, puisqu’on est presque obligé de nous montrer la menace, lui faisant automatiquement perdre son pouvoir. Voir le visage déformé d’un personnage qui ouvre la porte d’une cave ténébreuse stimule notre imagination, car notre cerveau passe en revue toutes les atrocités qui pourraient s’y trouver, alors que nous montrer un monstre, aussi horrifique soit-il, nous invite à avoir une approche plus pragmatique de la confrontation. S’il a des yeux, c’est qu’on peut se cacher de lui, s’il a de la chair, c’est qu’il peut saigner, s’il nous touche, c’est qu’il est tangible, etc…
C’est pour cela que j’ai toujours été ambivalent sur les tentatives d’illustrations d’ouvrages existants, comme coincé entre l’envie d’avoir une vision à mettre sur un nom et la peur de tuer la magie de ma propre imagination. Dans les tentatives récentes, on peut noter la série des Carnets de Lovecraft aux éditions Bragelonne ou encore les nouvelles brillamment illustrées de François Baranger, dont vous pouvez retrouver plus haut l’une des toiles de L’Appel de Cthulhu. Les deux volumes du comics Nightmare Factory sortis respectivement en 2007 et 2008 adaptent quant à eux certaines histoires de Thomas Ligotti, mais comme les nouvelles présentent datent des années 80, on ne peut pas les considérer comme des récits modernes. Certains numéros du Hellboy de Mike Mignola (créé en 1994) et du Sandman de Neil Gaiman (de 1989 à 1996) empruntent aussi parfois certains éléments de la mythologie lovecraftienne pour étoffer leurs récits.

Post-an 2000, on retrouve dans les rayons des romans graphiques comme The Filth (2003) et Nameless (2015) de Grant Morrison, la trilogie d’Alan Moore The Courtyard (2003), Neonomicon (2010) et Providence (2015), ou encore Hellstar Remina (2005) du mangaka Junji Ito. Tous ces récits reprennent une certaine vision de l’horreur cosmique, que ce soit par la présence d’entités transdimensionnelles, du Nécronomicon, de sociétés secrètes ou d’une menace incompréhensible venue de l’espace, sans pour autant réussir à capturer la froideur du frisson que peuvent provoquer des histoires contenues comme Le Tertre, Je suis d’ailleurs, La Maison de la sorcière ou encore Les Rats dans les murs.
Plus récemment encore, le run de Ram V sur Aquaman en 2023 a permis la naissance de la mini-série Andromeda, dans laquelle une créature exilée dans l’espace revient sur Terre et s’attaque aux humains en manifestant physiquement leurs plus grandes peurs. Le Bestiaire du crépuscule (2022) de la Française Daria Schmitt est également une œuvre que je recommande aux amateurs d’ambiances macabres, mais qui est plus un hommage poétique à Lovecraft qu’un récit d’horreur. Enfin, le dernier coup de cœur d’un peu tous ceux qui s’intéressent à cette mouvance artistique s’appelle Gideon Falls, un récit terrifiant de 27 numéros publiés entre 2018 et 2020, scénarisé par Jeff Lemire et illustré par Andrea Sorrentino, racontant la malédiction d’un immeuble récurrent, la grange noire, qui traverse le temps en apportant dans son sillage la folie et la mort.

L’évolution passant par le mélange
L’une des façons de témoigner de l’héritage d’un genre littéraire, c’est de voir comment ses lecteurs s’en sont inspirés pour alimenter leurs propres visions artistiques. En effet, ressasser encore et encore les mêmes histoires, les mêmes schémas narratifs et les mêmes ambiances peuvent vous donner un sentiment de sécurité, mais ce n’est pas ce qui va être le plus stimulant intellectuellement. L’horreur cosmique, pour survivre au-delà du format court et de son ambiance années 1920, a dû être exportée et mélangée à d’autres sous-genres littéraires. C’est de cette façon que notre imaginaire évolue, qu’on le veuille ou non. Tous les mélanges ne vont pas forcément fonctionner, les inspirations ne vont pas nécessairement nous apporter le même frisson, mais chaque proposition a le mérite d’élargir un peu plus la toile de notre inconscient collectif.
L’horreur n’intervient donc plus uniquement dans des environnements fantastiques, mais s’insère dans la science-fiction, le polar, l’humour, le pastiche, le réalisme, ou bien l’action et l’aventure. La Quête onirique de Vellitt Boe par exemple, livre écrit par Kij Johnson en 2016, se passe dans le célèbre monde des rêves (le parallélisme du titre avec celui de Kaddath l’inconnue ne vous aura pas échappé), tout en racontant une histoire à l’opposé de ce que H.P.L. nous faisait vivre avec son personnage de Randolph Carter.
L’écrivain chilien Gilberto Villarroel a quant à lui décidé de placer son personnage de Cochrane au XIXème siècle et de lui faire vivre des aventures réminiscentes des plus grands succès de Lovecraft, comme dans Cochrane vs Cthulhu (2021) et plus récemment Lord Cochrane et les Montagnes Hallucinées (2024). L’envie de prendre le bestiaire de l’horreur cosmique pour en faire quelque chose de plus léger semble être une façon assez populaire de s’approprier l’imagination débordante de l’écrivain américain, sans être ankylosé par ses thèmes, ses obsessions et ses peurs existentielles. Entre 2007 et 2017, David Wong s’est amusé à créer dans sa série John meurt à la fin (composée de John meurt à la fin, Ce livre est plein d’araignées et un troisième tome non traduit à ce jour intitulé What the hell did I just read ?), un monde absurde dans lequel deux abrutis parviennent à voir et à comprendre le langage de puissances cosmiques belliqueuses en ingurgitant de la sauce soja.
Dans un effort littéraire bien plus abouti, le romancier espagnol Edgar Cantero a livré en 2017 l’excellent Meddling Kids, hélas toujours pas traduit en français. Si vous êtes familiers du Club des cinq et de Scooby-doo, surtout en VO, vous aurez reconnu le clin d’œil du titre, “meddling kids” étant le nom que donnent les méchants démasqués aux enquêteurs en herbe. Il s’agit donc d’un pastiche de ce format où l’on retrouve un simili-scooby gang plusieurs années après une affaire qui a mal tourné. Habitués à démasquer des hommes d’affaires cupides, ils ont fini par se retrouver devant une véritable horreur des temps immémoriaux. Un livre qu’il faut absolument lire. Je ne vais pas m’attarder sur la trilogie d’horreur/science-fiction du Rempart Sud de Jeff VanderMeer, puisque je l’ai déjà chaudement recommandée ici, et je ne vais faire que mentionner le roman Let the Sleeping Gods Lie de David J. West, qui se déroule dans une ambiance western, puisque je ne l’ai pas lu.

La nouvelle vague
C’est une évidence, et une évidence heureuse, mais les auteurs modernes ont des profils bien plus variés que ceux que l’on pouvait trouver dans les magazines Weird Tales et Mystery Tales au milieu du siècle dernier. Le genre de l’horreur cosmique n’est en effet plus réservé à une démographique monochrome, car son lectorat et ses écrivains ont évolué en même temps que la société. Cependant, la littérature ne s’abaisse pas à donner des médailles de participation à tout ce qui est nouveau et inédit, et la diversité avérée des nouveaux écrivains n’a rien de gratuite.
Si j’insiste sur le fait que ce soit une bonne chose, c’est parce que la multiplicité des points de vue est rigoureusement essentielle à la pérennité d’un genre. Cela ne veut pas dire que tous les romans, les nouvelles et les sagas vont être de qualité, ni que nous sommes obligés de les aimer, mais ces ouvrages auront toujours le mérite d’ouvrir des portes dans notre imaginaire, que ce soit via une interprétation inédite ou une approche culturelle inexplorée. Qui peut se targuer de connaître une auteure de Lovecraftian Horror des années pulp autre qu’Hazel Heald (qui, de surcroît, est surtout connue pour avoir collaboré avec le maître sur des nouvelles comme L’Horreur dans le musée) ? Aujourd’hui, en revanche, nous avons des personnes qui font intégralement partie du regain de force du mouvement comme Ruthanna Emrys et sa réinterprétation de L’Ombre sur Innsmouth dans Winter Tide (2017), Jennifer Giesbrecht et son monstre qui rôde dans The Monster of Elendhaven (2019), le détective tentaculaire qui va aider l’enfant abusée dans Hammers on Bone de Cassandra Khaw, et autres Caitlín R. Kiernan que vous verrez plus bas.
Les thèmes racistes et la vision arriérée xénophobe qui pouvaient germer dans l’esprit d’un homme seul il y a cent ans ont eux aussi été évacués, parfois avec tendresse (comme chez Victor LaValle que vous retrouvez aussi plus bas) et parfois avec violence. Ce qu’essaie de faire la nouvelle génération, c’est d’élargir le spectre des possibles avec les bases qui ont été établies dans les histoires que vous connaissez déjà tous par cœur. C’est ce que j’ai moi-même modestement essayé de faire avec ma nouvelle La Vie est une fête, publiée dans le numéro 32 du magazine Gandahar, dans laquelle un Grand Ancien pacifique se rend régulièrement dans un village du Mexique pour y faire la fête avec les villageois. Il est important pour nous lecteurs de voir se diversifier les regards et les rapports de force, ne serait-ce que pour ne pas se retrouver à raconter indéfiniment les exactes mêmes histoires. Par exemple, plutôt que d’avoir encore et toujours un Occidental qui regarde de l’extérieur un groupe de païens indifférenciés prier un dieu dans une langue qu’il ne comprend pas, pourquoi ne pas chercher à connaître le point de vue d’un des cultistes ? Il y a plus à raconter dans ce schéma narratif qu’un regard extérieur sur des autochtones en slip qui dansent à la pleine lune, sans quoi la littérature s’essouffle.
En revanche, s’il y a bien une chose qui n’a pas changé, c’est l’obsession pour le format court ou semi-court. C’est comme si l’horreur cosmique ne pouvait correctement se consommer qu’à petites doses, en témoignent les plusieurs recueils qui ont pullulé ces dernières années. On peut citer Tales from the Gas Station: Volume One de Jack Townsend (2018), un livre adapté d’une série de Creepypastas publiées originellement sur YouTube et qui racontent les étranges événements entourant une station service; Tales from Brackish Harbor (2022) qui réunit plusieurs auteurs et auteures autour d’une ville portuaire fictive; ou encore A Lush and Seething Hell de John Hornor Jacobs (2019), qui se compose de deux novellas séparées, l’une traitant de la dictature en Argentine et l’autre d’une histoire folklorique d’esclaves du sud des USA.
Comme vous pouvez le constater dans les titres que je viens d’évoquer, ils n’existent tous qu’en version originale anglophone au moment où ces lignes sont écrites, ce qui est extrêmement frustrant sur plusieurs points. Tout d’abord, cela rend leur diffusion difficile à un public francophone, et je sais que j’aurais beau faire une présentation exquise d’un ouvrage captivant, s’il n’existe qu’en anglais, il y a peu de chance que mes lecteurs s’y attellent. Ensuite, cela exclut indirectement les potentiels autres livres d’horreur cosmique qui se cacheraient dans des langues que je ne sais pas lire, car si on ne traduit pas les ouvrages américains (le plus gros du marché), alors quid des auteurs hispanophones, japonais, chinois, arabes ou encore russes ? Il existe peut-être, quelque part, des récits lovecraftiens incroyables que je ne pourrais jamais lire, car jamais traduits, et cela me rend littéralement fou de rage. Même les “gros” noms américains les plus productifs, comme Andrew Van Wey ou Laird Barron, n’arrivent pas à se faire traduire. Ceci étant dit, je refuse de désespérer. Le processus d’exportation d’une œuvre peut prendre du temps et il faut surtout se rappeler que l’horreur cosmique est un genre de niche qui n’est pas le plus lucratif (sauf pour les rééditions quasi-annuelles de Lovecraft). Néanmoins, qu’un roman comme The Croning de Barron (2012) n’ait toujours pas trouvé preneur en France me laisse dubitatif.
Maintenant que ce tour d’horizon a été fait, laissez-moi vous présenter cinq livres modernes de lovecraftian horror qui devraient vous plaire. Il y en a trois qui ont été traduits et deux autres qui n’existent hélas qu’en anglais.
5 livres qui ne devraient pas vous décevoir :

Le Bureau des atrocités de Charles Stross (2004)
Comme pour A Lush and Seething Hell, ce livre se présente comme un gros roman mais se compose en réalité de plusieurs histoires d’une même chronologie, celle de The Laundry Files (littéralement, les dossiers de la laverie), racontant les enquêtes du consultant britannique Bob Howard, un expert de l’occulte. Ce livre contient donc les novellas Les Archives de l’atrocité, La Jungle de béton et À l’intérieur de la machine épouvante, trois récits qui vont mêler espionnage, humour, science-fiction et horreur lovecraftienne. Même si le côté humoristique peut ne pas vous brancher, sachez tout de même que la partie Jungle de béton a remporté le prix Hugo de la meilleure novella en 2005, ce qui peut encourager la curiosité.

La Ballade de Black Tom de Victor LaValle (2016)
Il se pourrait que ce soit mon livre préféré de cette sélection, mais c’est peut-être parce qu’il s’agit du tout premier que j’ai lu lorsque j’ai essayé de trouver des récits d’horreur cosmique modernes il y a plusieurs années. J’y suis donc très attaché. De plus, l’auteur m’a apporté une vision plus élargie sur l’héritage de Lovecraft, en ce que je ne m’étais jamais vraiment demandé comment les auteurs à la peau noire vivaient son inébranlable popularité en dépit de ses idéaux d’un autre temps. Il y a brillamment répondu en lui dédiant son roman “avec tous (ses) sentiments contradictoires”. On respecte le travail, mais on n’oublie pas l’homme. À l’instar de Winter Tide avec Innsmouth évoqué plus haut, La Ballade de Black Tom reprend L’Horreur à Red Hook, une nouvelle ouvertement xénophobe, en la racontant à travers les yeux d’un autre personnage, le fameux Black Tom. C’est un excellent livre, même en occultant le positionnement politique de faire de la pire histoire de Lovecraft quelque chose de nouveau.

Les Agents de Dreamland de Caitlín R. Kiernan (2017)
Faisant partie de la série des Tinfoil Dossier, je dois confesser que je n’ai pas du tout accroché aux Agents de Dreamland lorsque j’ai essayé de le lire pour la première fois. Cependant, le livre se retrouve irrémédiablement dans les listes de beaucoup de lecteurs, et souvent en très bonne place, alors j’en ai conclu que c’était moi qui étais passé à côté de quelque chose. Dans mes souvenirs, on retrouve deux agents, un homme et une femme, qui tentent d’empêcher une secte de réveiller quelque chose de sordide. Je pense que le côté “classique” du set up m’avait refroidi, même avec des enquêteurs proactifs et non des archétypes monolithiques, mais comme je l’ai dit, tout le monde semble adorer.

The Fisherman de John Langan (2016)
Voilà un autre livre dont l’absence de traduction me fend le cœur. The Fisherman de John Langan (un récipiendaire du prix Bram Stoker) est une fable macabre qui mêle à la fois les thématiques post-modernes de l’homme face à lui-même, tout en incluant un conte folklorique et une entité primordiale. Si au départ on pense suivre deux hommes qui essaient de surmonter la solitude à travers des parties de pêche, une longue histoire racontée par un personnage tiers dans un diner vient bouleverser le récit à mi-chemin. Les événements du passé vont bien entendu se jumeler avec le présent, mais il est curieux de voir à quel point l’auteur n’a pas hésité à écrire une novella quasiment indépendante en plein milieu de son roman. Les thèmes explorés sont ceux du deuil, de la folie vengeresse dans laquelle il nous plonge, ainsi que les forces que l’on est prêt à réveiller pour ramener l’être aimé. Une petite merveille.
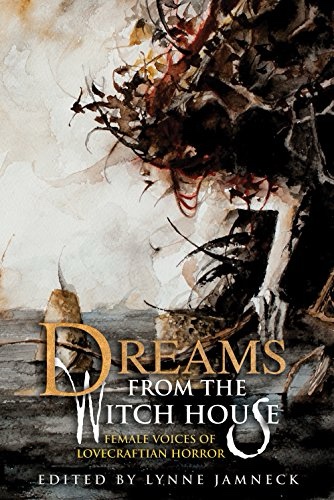
Dreams from the Witch House (2018)
Peut-être le livre le plus excitant de cette liste, n’existant, lui non plus, malheureusement pas en langue française. Il réunit parfaitement ce qui est déjà bien dans l’horreur cosmique et ce dont on a besoin pour le futur : on garde le format star du genre, à savoir la nouvelle, et on le fait explorer par des personnes qui apportent un point de vue inédit à ces thèmes ancestraux. Cette compilation contient des histoires courtes uniquement écrites par des femmes, et pas des moindres, puisque dans le line-up on peut notamment compter sur Joyce Carol Oates (récipiendaire de plusieurs prix Bram Stoker, World Fantasy ou Femina étranger), Tamsyn Muir (auteure néo-zélandaise de la géniale série de La Tombe Scellée, une grosse découverte de 2023), Lois H. Gresh (soixante nouvelles publiées à son actif et membre de la rédaction Science Fiction Weekly), Amanda Downum (auteure de The Bone Palace), Caitlín R. Kiernan mentionnée juste au-dessus, ou encore Storm Constantine (connue pour la série Les Wraeththu). Comme je l’ai dit dans l’introduction, je ne fais pas de politique sociale et je ne veux pas surestimer un travail en le jugeant uniquement sur les spécificités de son auteur, mais il me semble néanmoins important, voire même essentiel, de se plonger dans les points de vue qui nous sont inatteignables. Il n’y avait déjà pas beaucoup de femmes dans les récits de Lovecraft, ni beaucoup de publicités pour celles qui écrivaient de l’horreur, alors ce recueil est l’occasion parfaite pour y remédier et découvrir de belles choses.

